Quels sont les grands défis de l’école au XXIe siècle ? Qu’est-ce qu’une pédagogie efficace à l’heure de TikTok, de Twitch et de YouTube, des intelligences artificielles et bientôt de l’informatique post-quantique ? Comment réformer l’enseignement supérieur ? Quels sont les leviers à privilégier pour réconcilier les jeunes générations avec le système éducatif et développer de nouvelles formes d’intelligence collective ?
À la lumière d’un parcours aussi multiple qu’atypique, et avant tout de son expérience en qualité de co-fondatrice et directrice générale du Quest Education Group, présent à Lyon, Paris et Bordeaux, Valérie Dmitrovic a bien voulu revenir sur ces sujets rien moins qu’essentiels pour qui s’interroge sur notre capacité à transformer nos sociétés. En nous offrant une bouffée d’air frais et un vent d’optimisme constructif que l’on ne saurait trop apprécier face à l’impasse anxiogène dont semblent désormais prisonniers nombre de nos décideurs.
Un témoignage d’autant plus précieux qu’il se nourrit à la fois de réflexions et d’analyses, mais encore d’expériences concrètes au contact quotidien des élèves, de leurs parents et du corps enseignant. Où il est question d’innovation, de formes collaboratives et co-constructives, d’industries du présent et du futur telles que le jeu vidéo et la cybersécurité, pour un entretien en phase avec les métamorphoses de notre temps.
. Gaming Campus
. Guardia Cybersecurity School
. Quest Education Group
Propos recueillis par Laurent Courau
Illustrations © Mondocourau.com & Quest Education Group

Valérie Dmitrovic © Quest Education Group
Démarrons peut-être par ce qui occupe l’essentiel de vos journées ? Qu’est ce qui a motivé la création de Quest Education Group, ce récent groupe d’enseignement privé centré sur les industries du numérique, à commencer par celles du jeu vidéo et de la cybersécurité ?
Qu’est ce qui nous y a poussés, avec mes associés Thierry Debarnot et Jean-Baptiste Racoupeau ? Déjà, ils ne sont pas de la même génération que moi et adorent les jeux vidéo. J’aime beaucoup ce média aussi, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons.
Ce qui me fascine, c’est que le jeu vidéo concentre désormais toutes les formes de création artistique, et de manière immersive. C’est à la fois beau et intéressant, technologique et créatif. Tout ce que j’aime ! De plus, les jeux vidéo constituent encore le mal incarné pour certains. Et j’avoue que ça me titille. Que ça m’intéresse. Ce sont des sujets que nous avons envie d’explorer, que nous avons envie de défricher.
Bien sûr, les mentalités ont énormément changé depuis la création de Gaming Campus, jusque dans les rapports que nous entretenons avec les parents d’élèves. Tout le monde a compris qu’il se passe quelque chose et que c’est passionnant. Et il est vrai que j’apprécie, aussi, de me trouver à l’avant-garde. Quand il y a débat, ça m’intéresse. Lorsqu’il y a des changements de paradigme, ça me passionne.
De plus, les besoins sont importants comme l’a souligné l’audit réalisé sur la filière d’excellence du jeu vidéo, dans le cadre du plan d’investissement France 2030. Avec l’idée que la France reste à la pointe des industries culturelles et créatives. Et puis du côté de la Guardia Cybersecurity School, la demande s’avère encore plus massive. Je pense que la cybersécurité va aller encore plus vite, évidemment. On le voit bien.

Revenons sur votre parcours, étonnamment varié, depuis le monde des affaires, la géopolitique et les affaires internationales, jusqu’à l’enseignement et la création d’un groupe d’enseignement privé centré sur les métiers du numérique, plus spécifiquement des jeux vidéo et de la cybersécurité ?
J’ai commencé par une école de commerce. Une formation très pratique, très orientée sur le business. Ce qui constitue une facette de ma personnalité, mais ne m’alimentait pas suffisamment en termes de connaissances et de conceptualisation. En parallèle de mes cours dans cette école de commerce, j’allais écouter des conférences d’architecture ou de philosophie. J’assistais à des cours d’histoire de l’art. Une base très importante pour la suite de mon parcours.
Et puis, mes origines m’ont rattrapée. J’ai eu la chance que mon père soit serbe, amoureux de la Russie, mais aussi « de ne pas grandir avec lui ». Une absence intéressante parce qu’elle participe à vous construire. Au départ, je ne savais pas pourquoi je m’intéressais autant à la Russie. Ce n’est que plus tard, en retrouvant mon père à l’âge de 20 ans, que j’ai découvert qu’il partageait cette même passion.
Lors de l’une des conférences mentionnées plus haut, je rencontre Hélène Carrère d’Encausse. Une grande spécialiste de la Russie et du monde slave, une historienne incroyable, mais aussi une femme politique, ancienne députée européenne, et la première femme à occuper la fonction de secrétaire perpétuelle de l’Académie française. Et là, c’est le coup de foudre ! Son influence me pousse vers un DEA à Sciences Po, où je vais travailler à la fois sur mon amour pour la Russie et sur la recherche de mes origines balkaniques.
Je postule donc à Sciences Po, mais mes parents me disent qu’il n’en est pas question. Ma mère me rappelle que j’ai fait une école de commerce et m’intime de travailler. Hors, pour moi, il n’était pas question de suivre ce type d’injonction. Je pars donc faire mon DEA à Sciences Po Paris. Je me régale et poursuis encore plus loin mes recherches. Je vais à l’Inalco, l’Institut national des langues et des civilisations orientales, pour y apprendre le serbo-croate et un peu de russe. Dans ce cadre, je découvre plein de choses, dont l’Empire ottoman et l’Empire austro-hongrois. Je revisite tellement de choses intéressantes qui constituent l’Europe et me construis par la même occasion.
Je suis jeune. Et à cet âge, on a aussi besoin de fondamentaux pour avancer. Arrive le moment où je m’apprête à me lancer dans un doctorat. Mais je réalise alors que ce n’est plus du tout mon histoire et qu’il est temps d’aller vers ce que j’aime. Et ce que j’aime le plus, c’est l’enseignement, tout particulièrement l’enseignement supérieur.
Et justement, comment vous est venu cet amour de l’enseignement ?
En arrivant à Paris pour faire mon DEA à Sciences Po, il fallait bien que je mange et que je paie mon loyer. J’avais annoncé à mes parents que je me débrouillerais seule. C’est ainsi que j’ai rencontré Hervé Lecat, qui avait fondé la société Objectif Math par le biais de laquelle des étudiants des grandes écoles donnaient des cours à de jeunes lycéens.
Objectif Math a donc constitué ma première expérience dans ce domaine. C’est en travaillant et en m’investissant dans ce projet, en donnant moi-même de nombreux cours que j’ai découvert ma passion de l’enseignement. Je suis ensuite passée par l’enseignement supérieur privé, où l’on dispose d’une grande marge de manœuvre créative.
On a ainsi pu répondre à plein de belles opportunités avec Marc Sellam, le patron du groupe IONIS. Quelqu’un d’actif et de rapide, avec lequel j’ai beaucoup aimé travailler et prendre de plus en plus de responsabilités. Jusqu’à ce qu’en 2018, mon projet arrive à maturité et coïncide avec celui de l’un de mes anciens élèves, Thierry Debarnot.
Nous créons ensemble Gaming Campus, qui a constitué la première pierre de Quest Education Group. Ce qui m’a permis de reboucler la boucle, entre business et enseignement. Depuis que j’avais fait une école de commerce, je savais qu’un jour je serai dirigeante. Je l’avais perçu dès l’âge de 20 ans.
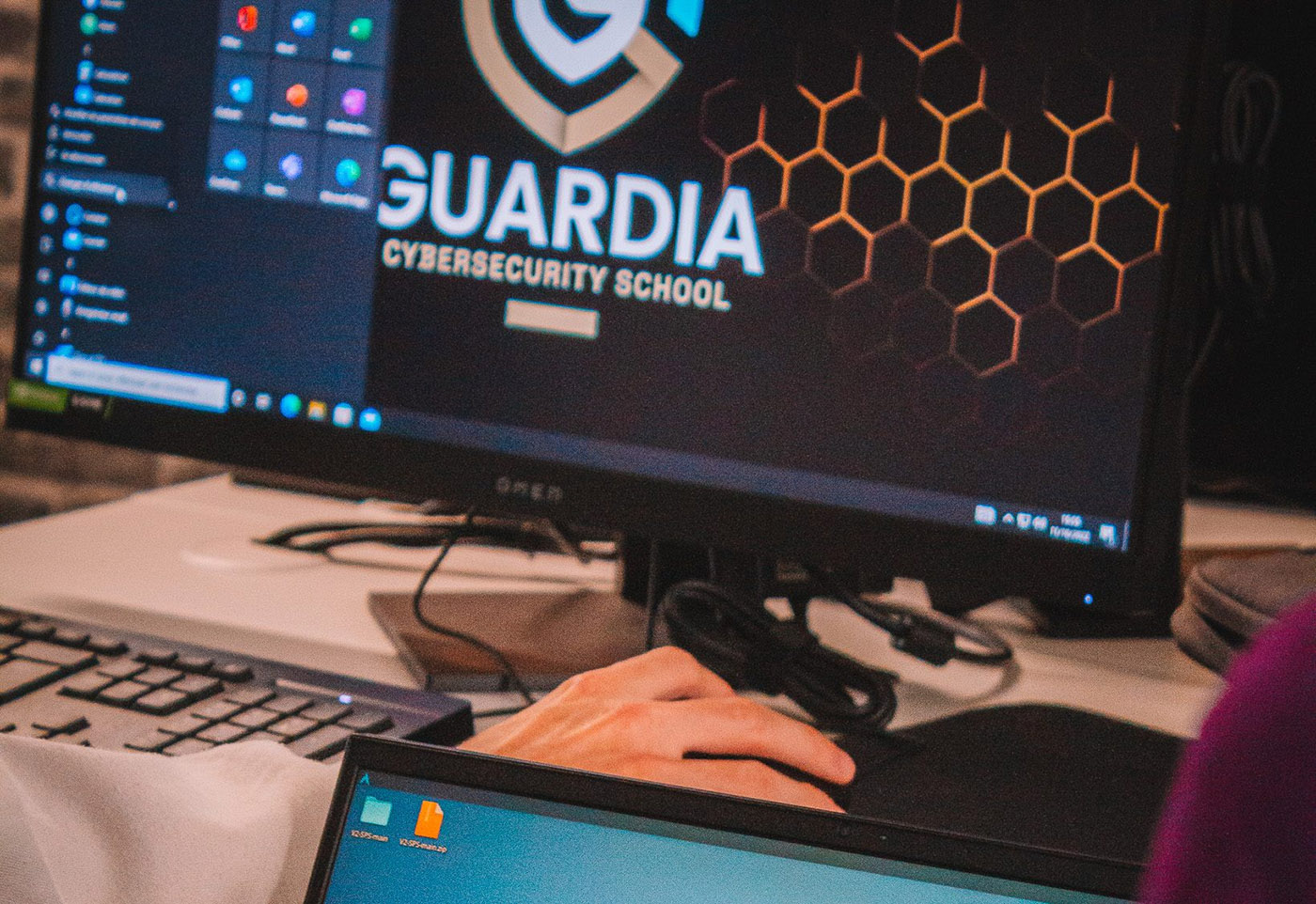
D’après votre parcours, on imagine que vous auriez pu rejoindre l’éducation nationale ? Pourquoi avoir choisi l’enseignement privé ?
En ce qui concerne l’éducation nationale, je ne rentrais dans aucune case à cette époque. J’avais fait une école de commerce. Aussi, si je voulais donner des cours, il fallait que je donne des cours de marketing. Or, j’aimais beaucoup plus l’économie, la géopolitique et les cours plus conceptuels.
Et surtout, j’avais envie d’innover ! Ce ne sont pas des structures qui me correspondent, tout simplement. J’ai besoin de structures beaucoup plus agiles, au sein desquelles on peut créer, construire, imaginer et mettre en œuvre.
À ce propos, quel regard portez-vous sur ce que beaucoup qualifient aujourd’hui de « crise de l’enseignement supérieur et de l’enseignement public » ?
Cette crise me semble surtout liée aux nouveaux usages des étudiants, des jeunes en général, ainsi qu’aux nouveaux besoins des entreprises.
Ce qui se pratique toujours dans l’enseignement supérieur ne correspond pas à ces changements de paradigme. Les modèles en vigueur datent de plus d’un siècle, avec des cours « top down », avec des cours magistraux. Alors que nous nous trouvons justement aujourd’hui dans des formes collaboratives où l’individu doit participer, agir, faire et co-construire.
Actuellement, lorsqu’un lycéen ne trouve pas suffisamment de nourriture intellectuelle (ou pratique) dans ses cours, il va mener ses propres recherches sur Internet, notamment auprès d’influenceurs qui traitent de ses thématiques préférées. Il va dénicher des tutoriaux, des contenus qui le passionnnent souvent beaucoup plus que ce qu’on lui propose en cours. Cet accès simplifié à un vaste éventail de ressources correspond davantage aux nouvelles manières d’apprendre.
Cependant, mon propos ne sera jamais de dénigrer le métier d’enseignant. De nombreux professeurs sont extraordinaires, mais ne disposent pas des moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce qu’ils souhaiteraient. Raison pour laquelle je préfère rester dans la nuance. Je ne veux pas critiquer, c’est important.
En parlant de méthodes d’apprentissage, la pédagogie par projet semble occuper une place importante dans vos écoles ?
En effet, la pédagogie par projet est importante. Pour ma part, je l’ai testée dans les écoles où je travaillais, d’abord à petite échelle, puis à plus grande échelle. J’ai mené mes propres recherches, en lisant énormément de thèses et de travaux pratiques. J’ai suivi ce qui a été fait à l’Université catholique de Louvain, en échangeant avec eux lorsqu’ils ont tout remis à plat pour changer de modèle en l’an 2000. Puis, j’ai modélisé et présenté ces travaux lors d’une conférence des grandes écoles. Et enfin, en 2018, j’ai mis cette approche en œuvre avec notre équipe, au travers d’une pédagogie « full projet », une vraie pédagogie par projet.
Dans un parcours d’enseignement classique, les emplois du temps sont récurrents, avec des matières saucissonnées : une première matière, une deuxième matière, puis une troisième et ainsi de suite au cours de la journée. Jour après jour, semaine après semaine, les mêmes matières sont cloisonnées en silos. On est resté sur un modèle où l’étudiant est passif, assis sur une chaise. Il note ou il écoute. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l’autre. Il n’est pas acteur, il reste passif.
Au final, on a des étudiants qui s’ennuient, qui se dispersent. N’étant plus aujourd’hui dans une culture de la retenue comme ce fut le cas à d’autres époques, un étudiant qui a envie de s’exprimer s’exprime. Et il va le faire sous différentes formes. Ça peut être de l’indiscipline, il peut regarder par la fenêtre et rêver, mais plus souvent, il va s’exprimer verbalement. Ce qui nous donne in fine des structures d’enseignement supérieur où il y a pas mal de « chahut ». Ce ne sont pas des conditions d’apprentissage positive. Aujourd’hui, pour leur redonner l’envie d’apprendre, il leur faut de la collaboration, de la co-construction et de l’écoute.
Cet ancien modèle n’est plus adapté à notre monde, aux étudiants, ou aux intervenants professionnels qui, frustrés dans leur envie de transmettre et de partager, finissent par se demander ce qu’ils font là.

Dans la pédagogie par projet, l’étudiant se trouve au centre. Pour moi qui ai pratiqué les arts martiaux japonais, l’intervenant professionnel est comparable à un « maître ». Le sensei, ou maître, est celui qui est le plus avancé. Il n’est pas « supérieur », il est juste plus expérimenté. Il est là pour aider l’étudiant à réaliser son projet. Collectivement, par petits groupes de deux ou trois élèves. Et c’est aussi intéressant dans la posture, dans le positionnement, parce que le sensei montre et agit avec les autres. Ce qui me semble fondamental. Quelque part, ils se retrouvent au même niveau dans l’apprentissage. En retour du savoir qu’il transmet, l’intervenant professionnel va se nourrir de ces jeunes esprits qui ont été éduqués différemment de lui et qui ont d’autres usages.
L’expérience est enrichissante pour l’un comme pour les autres. Ils co-construisent des apprentissages, ensemble. Il y a une acquisition de connaissances et de savoir-faire opérationnel. Nous sommes sur une approche par compétence.
Concrètement, comment mettez-vous en place cette pédagogie par projets dans le cadre de vos écoles ?
Bien sûr, ça demande une structuration, laquelle passe ici par un cahier des charges très précis, envoyé en amont à l’étudiant. Celui-ci est rédigé par l’intervenant professionnel. Il est bien sûr contrôlé et validé, voire amélioré, par la direction de l’école et par sa direction pédagogique.
Ce cahier des charges présente l’intervenant et sa spécialité. Il explique les matières auxquelles on se réfère. Quel que soit leur nombre, car on désilote. Ainsi, l’étudiant sait déjà avec qui il va travailler et peut immédiatement se connecter à son intervenant, via LinkedIn ou d’autres réseaux. Ce document va aussi décrire le projet avec précision, dans son contexte et avec sa propre problématique.
Dans ce cahier des charges, nous allons également préciser les connaissances et les compétences que l’étudiant aura acquises à la fin du projet. Celles sur lesquelles il sera noté, lors d’une soutenance orale ou de la remise d’un dossier. Tout est transparent, tout est clair. L’étudiant connaît ses critères de notation. C’est sans surprise.
Pourriez-vous nous donner quelques exemples pour les personnes qui auraient du mal à imaginer ce que sont ces projets dans vos différentes écoles, au sein de Gaming Campus ?
Si je prends notre école G. Tech, qui forme des développeurs informatiques pour le secteur des jeux vidéo, il va falloir démarrer par la base, soit apprendre à programmer. On va, par exemple, leur proposer une introduction à la programmation en C sur trois semaines. La durée de ce projet variant en fonction de la complexité des connaissances à acquérir.
Si je prends notre école G. Art, qui forme des infographistes 2D et 3D, il peut s’agir d’un projet de « concept art ». Ils vont commencer par se familiariser avec les outils nécessaires à l’élaboration artistique d’un jeu video, puis s’atteler à l’exécution de ce projet de création durant deux à trois semaines.
Si je prends notre école G. Business, dont la matière fondamentale est le marketing, on va commencer par une vraie étude de marché pour un jeu vidéo, pendant deux ou trois semaines.
Vous évoquiez plus tôt les différences entre un étudiant de la seconde moitié du XXème siècle et un étudiant des années 2020. Au travers de votre propre parcours, avez-vous noté une évolution des attentes et des postures de vos étudiants ?
Comme je le disais, les étudiants ont dorénavant un grand éventail de ressources à leur disposition sur Internet. Ils n’attendent plus et vont chercher par eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Par exemple, nos étudiants de la Guardia Cybersecurity School ne nous ont pas attendus. Ils adorent la cybersécurité. Ils ont déjà les mains dedans, ils apprennent par eux-mêmes, ils se testent.
L’école doit donc leur apporter autre chose que des dictées de savoir. Ce n’est juste plus possible.

Pour rebondir sur l’importance des tutoriaux et de l’auto-formation, est-ce que l’accélération technologique et la remise en cause constante des compétences qui en découle n’oblige pas les professionnels à une sorte de formation continue permanente ? Est-ce que le rôle d’une école ne serait pas désormais de proposer aussi des compléments de formations ?
Bien sûr, nous sommes sur des métiers techniques et créatifs où tout évolue tellement vite. Celles et ceux qui n’apprennent continuellement se retrouvent vite complètement largués.
Et c’est d’ailleurs pour cette raison que la pédagogie par projet nous « apprend à apprendre ». Le cahier des charges déjà évoqué liste ainsi des ressources que les étudiants se doivent de consulter pour préparer leur projet. Ils doivent apprendre à se débrouiller et à s’adapter. L’intervenant ne donne pas toutes les explications de A jusqu’à Z. Nous encourageons aussi l’apprentissage par les pairs, parce qu’on peut avoir des camarades plus avancés que nous dans certains domaines. On apprend aussi bien par les pairs, que par les intervenants professionnels ou les professeurs.
De même, la pluralité des projets qui sont proposés à nos étudiants développe l’adaptabilité, la confiance en soi, la communication et la capacité à travailler en équipe, une compétence aussi recherchée que rare.
Au fil des semaines que durent un projet, l’intervenant professionnel re-théorise, re-modélise pour aider l’élève à partir de sa propre expérience concrète, à partir de son métier et de son vécu. Vient ensuite le feedback pendant les soutenances, qui est constructif d’apprentissage. Le modèle est magnifique, car la pratique est toujours en évolution permanente, ce qui correspond à la fois aux usages de nos élèves et aux besoins des entreprises.
Dans le monde actuel, les entreprises et les organisations, quelles qu’elles soient, ont besoin de personnes entreprenantes, agiles et compétentes.

Envisagez-vous une sorte de formation continue payante pour vos anciens élèves ? Je pense notamment à la popularité des masterclass sur Internet, souvent très chères et auxquelles se prêtent de nombreuses personnalités du monde artistique et technologique.
Mieux que ça. En tant qu’école, je considère nous avons le devoir de proposer de la formation continue, à titre gracieux, à nos anciens élèves. Ainsi, nous avons mis en place une plateforme d’e-learning, à travers laquelle nous diffusons une grande quantité de contenus passionnants, dont des masterclass, etc. Bien que ceux-ci soient avant tout destinés à nos élèves en cours de formation, nos alumni peuvent aussi en profiter.
Plus tôt, vous nous avez rappelé que le jeu vidéo est un média qui englobe toutes les formes de création artistique. Est-ce que Gaming Campus n’est pas appelé à devenir une école d’art à part entière dans le monde, toujours plus numérique, d’après-demain ?
Tout à fait ! Une école d’art numérique, puisque nous assistons à une convergence des différentes formes de médias. Aujourd’hui, les effets spéciaux au cinéma utilisent les mêmes logiciels que l’industrie du jeu vidéo. Lors d’une visite récente au MIFA (Marché international du film d’animation d’Annecy), la convergence et les besoins similaires du jeu vidéo, du film d’animation et du cinéma nous ont semblé évidents.
Nous avons donc une école d’art, doublée d’une école d’informatique dédiée aux jeux vidéo, et il ne faut pas non plus négliger notre business school. C’est une composante souvent oubliée, alors qu’elle est majeure, voire fondamentale, pour que les jeux vidéo fonctionnent et se vendent. Même s’il est parfois difficile d’analyser ce qui a fait qu’un jeu ait bien marché. Il y a besoin de chefs de projet, en matière de communication et d’entrepreneuriat. Cette école s’avère donc indispensable et tout aussi importante que les deux autres.
Que répondriez-vous aux parents d’élèves inquiets de l’avenir de leurs enfants face à la montée des intelligences artificielles et à l’informatique quantique ?
Il semble encore difficile d’imaginer ce qui nous attend, mais je leur répondrais qu’il ne faut pas s’inquiéter puisque nous sommes là pour apprendre l’usage de ces technologies à leurs enfants.
Pour utiliser une métaphore, c’est un peu comme un enfant qui fait de la randonnée en montagne. Oui, ça peut comporter quelques dangers, mais l’important reste d’apprendre à connaître son environnement. Et pour en revenir aux intelligences artificielles, l’important est de savoir les utiliser. L’intelligence artificielle ne sait pas tout faire. Il y aura toujours un cerveau humain pour définir un besoin ou une problématique. Pour décider de ce que l’on va faire avec cette intelligence artificielle et de la manière dont elle va nous permettre d’avancer.
Je pense qu’il faut impérativement intégrer l’intelligence artificielle dans nos enseignements. C’est ce que nous sommes en train de faire avec toutes nos équipes et nos directeurs. On ne va pas dire à nos étudiants en G-Art de ne pas utiliser les intelligences artificielles. Au contraire, ils peuvent les utiliser mais le dire lorsque c’est le cas. Parfois, ils n’auront pas le droit de s’en servir parce qu’ils doivent d’abord apprendre à devenir des artistes afin, justement, de pouvoir mieux utiliser les intelligences artificielles par la suite.
Mais par moment, on leur dira aussi qu’ils peuvent y aller à fond, à condition qu’ils expliquent leur processus et la part que l’intelligence artificielle a pris dans leurs créations. C’est toujours pareil avec la technologie, il y a beaucoup de fantasmes. Mais c’est aussi ça qui est génial et on s’en amuse ! Pour conclure, à l’heure de cette mutation technologique historique, il faut absolument apprendre aux jeunes générations à utiliser l’intelligence artificielle. On ne peut pas leur interdire son usage, ce serait suicidaire.

Puisque nous sommes déjà en train de nous projeter vers le futur, que voyez-vous comme révolutions ou changements de paradigme importants, à venir dans les prochaines années en matière d’éducation et d’enseignement supérieur ?
La pédagogie par projet constitue déjà une première et belle étape. Mais je reste une chercheuse permanente et je n’arrive pas à m’en contenter. Il faut aller plus loin, encore et toujours. Notamment en matière de personnalisation, mais pas n’importe comment.
On peut imaginer des systèmes plus fluides, plus agiles, où l’étudiant vient pour effectuer un parcours précis. Où il choisit les compétences qu’il souhaite développer, quelle que soit l’année de référence des cours qu’il choisit. Parce que ce n’est pas un problème pour une étudiante ou un étudiant bien armé.
Pourquoi démarrer nécessairement en première année ? C’est aberrant. Certains étudiants ont le niveau requis pour entrer directement en troisième année. Sauf que nous devons faire face à une montagne d’obstacles. C’est la France et c’est comme ça. Il nous reste encore beaucoup de sujets à étudier, beaucoup à faire.
C’est comme une partie de jeu de Tetris qui commence. Et c’est là où ça devient drôle. On va pouvoir réfléchir avec nos équipes, mettre en œuvre et vérifier la qualité de cette mise en œuvre. Après, il faut suivre les grandes transformations : l’ordinateur quantique, post-quantique, etc. Il y a des changements de paradigme, il y a des changements politiques. Dans quel sens va-t-on aller ? Nous nous devons donc de rester attentifs aux signaux faibles et d’évoluer en conséquence.
Mais tout cela est vraiment passionnant. Par exemple, l’ordinateur post-quantique constitue une belle opportunité. En matière de cybersécurité, nous en parlions encore récemment avec TheGreenBow, société avec laquelle nous avons signé un partenariat. Il faut que les entreprises se protègent, mais aussi qu’elles anticipent le post-quantique qui va rendre nos données accessibles. Elles ne seront plus cryptées.
On sait que certains pays ont déjà la mainmise sur des données françaises. Ils n’attendent qu’une chose, c’est de pouvoir les décrypter. Ce qui sera possible d’ici une dizaine d’années ou moins. Ce qui constitue un boulevard en matière d’emploi. Nos écoles se doivent de répondre à ces demandes. D’anticiper ces métiers d’avenir. Nous ne sommes pas une énième école généraliste et en même temps, nous faisons face à des enjeux vraiment passionnants.
Nous devons aussi participer à une démocratisation de ces enjeux. Faire notre part, en envoyant nos étudiants dans les collèges pour expliquer. Et j’en profite pour lancer ici un appel. Si on pouvait m’entendre, si les proviseurs de lycée et de collège pouvaient m’entendre ! Montons des partenariats ensemble, dès demain ! Tout de suite ! Il est aussi important d’expliquer aux femmes qu’elles peuvent accéder à ces métiers, parce que c’est là que tout se joue. Vous voyez ? Il y a plein de choses à faire et je suis contente que nous nous trouvions à la pointe de tout ça avec nos écoles.

Vous venez d’évoquer la place des femmes dans ces filières professionnelles. Est-ce que le pourcentage d’étudiantes a évolué depuis l’ouverture de votre première école ?
Non, ça évolue tout doucement. Les femmes ne représentent encore qu’entre 10 et 12 % des élèves dans les écoles d’ingénieurs. On ne peut pas se battre tout seul, donc on travaille avec Ambition Jeu Vidéo, avec Loisirs Numériques. Il y a peu, on évoquait toutes ces thématiques avec le directeur général de Campus Cyber, puisque nous en sommes membres actionnaires. On évoquait aussi cela avec Sopra Steria, qui ont une super politique vis-à-vis des femmes dans leur entreprise.
Il faut aller chercher ces talents, mais cela va passer par un changement des mentalités. Et nous ne pouvons y arriver seuls. Il faudra donc accueillir des stagiaires dans nos écoles, dans les entreprises et mettre en avant des femmes sur les salons, afin que d’autres femmes puissent se dire que ça leur est accessible. Nous devons y travailler collectivement.
Campus Cyber fait beaucoup de choses. Tout le monde fait beaucoup de choses. Et ça va finir par porter ses fruits. Mais alors, sous combien de temps ? Moi, je suis optimiste. Je dis cinq ans. Un changement de génération, c’est cinq ans ? Peut-être un peu plus.
L’un des slogans de Quest Education Group est de « préparer le monde de demain ». Une réflexion essentielle, que l’on retrouve au cœur même de Mutation, notre laboratoire d’idées. Comment prépare-t-on les jeunes générations au monde qui advient ?
Oui. On revient toujours aux mêmes questions de management, de prospective, de veille et de gestion du changement. Des aspects que nous intégrons systématiquement dans tous nos cursus. Il y a toujours un aspect à la fois de veille technique et de veille créative. C’est la base. Nos directeurs sont en veille permanente. La pédagogie par projet nous aide aussi à inculquer cette dimension de prospective. C’est toujours pareil, il faut savoir capter les signaux faibles qui viennent de nos étudiants.
Et justement, je suis une passionnée et je crois qu’on n’a pas abordé du tout comment je vois les jeunes. Mais moi, je les vois toujours géniaux. Ce qui est exaltant, c’est que nous avons toute une équipe de passionnés qui travaillent chez Quest Education Group et nous adorons travailler avec les étudiants, avec la jeunesse. Ils sont les porteurs des germes du futur, de ce qui va évoluer et se transformer dans nos sociétés. Il est essentiel de rester à l’écoute de ces nouveaux usages et des signaux qu’ils nous envoient.
Il est aussi important de voyager. Il faut être à l’écoute du monde, partir à la rencontre d’autres cultures, découvrir d’autres entreprises. C’est indispensable. Certains de nos élèves reviennent d’un voyage d’apprentissage en Corée. Ils y ont vu et appris plein de choses. Ça les a nourris. Ce qui me semble très important à notre époque, face aux peurs que relaient et dont se nourrissent les médias de masse. Face au climat anxiogène du moment, qui reste bien pratique pour dominer les gens.
Cette question de l’anxiété qui bride les populations, plus qu’elle ne les pousse à agir et construire, me semble essentielle. Où et comment vous situez-vous par rapport à ces peurs traumatiques qui pourraient nous mener droit vers des lendemains qui déchantent ?
Nous contre-attaquons au travers d’écoles innovantes. Particulièrement sur les sujets déjà évoqués qui interrogent. Nous nous trouvons justement au cœur de ces débats. Certes, la presse et les médias débordent déjà de ces questions, mais il est possible de faire autrement, différemment.
Pour ma part, je trouve que la jeunesse nous apporte énormément. Cette nouvelle génération bouge. Elle agit, elle désire autre chose. Beaucoup de voix se font entendre, qui s’avèrent très intéressantes pour nous. Nous nous devons de les accompagner. En fait, je reste positive. Je garde foi en l’être humain, en notre capacité à collaborer et à construire ensemble. Nous passerons peut-être par une époque un petit peu plus difficile, mais il en ressortira forcément des belles choses.



