Déjà autrices d’ouvrages universitaires remarqués (citons, parmi d’autres, La Re-Création du Passé. Enjeux Identitaires et Memoriels pour la première et William S. Burroughs SF machine pour la seconde), Audrey Tuaillon Demésy et Clémentine Hougue s’attaquent ici à la question du Temps. Un dictionnaire « dissident » paru chez Riveneuve qui, par le biais d’une centaine de notices, permet au lecteur de naviguer, à loisir, entre hard et soft science, philosophie et nouvelles technologies, patrimoine et anticipation. L’objectif est aussi simple qu’ambitieux : se dégager du cadre universitaire tout en conservant la rigueur et la précision de la recherche académique.
Le Dictionnaire dissident du Temps est une somme de près de quatre-cent pages, qui donne accès, avec économie et exigence, à des notions complexes, et où la « Physique » (Océane Gusching) côtoie, par le plus grand des hasards, la « Poésie » (Céline Pardo), l’« Anarchisme » (Camille Mayer) l’« Archéologie » (Ségolène Vandevelde), le « Jeu » (Olivier Caïra) la « Langue » (Frédéric Landragin) et « Karl Marx » (Alain Bihr) la « Mémoire » (Joël Candau).
C’est dans ce réseau où chaque entrée répond aux suivantes, communique et résonne, un réseau à l’image des labyrinthes qui succèdent aux jardins d’égarement, qu’Audrey Tuaillon Demésy et Clémentine Hougue invitent le lecteur à déambuler, ou, pour reprendre les mots de Giuseppe Lovito : « Si auparavant on entrait dans le labyrinthe dans le but d’en sortir, renforcés dans ses propres connaissances ou ses propres principes, maintenant on y entre afin de l’habiter, conscients qu’il n’y a pas de sorties ou de parcours privilégiés pour le parcourir ».
Propos recueillis par Christophe Becker.
Illustration : Élément d’une horloge atomique © Lange Electronic
Le Dictionnaire dissident du temps, écrit sous la direction d’Audrey Tuaillon Demésy et Clémentine Hougue est paru en septembre 2024 aux éditions Riveneuve dans la collection En Marge !, dirigée par Solveig Serre et Luc Robène.
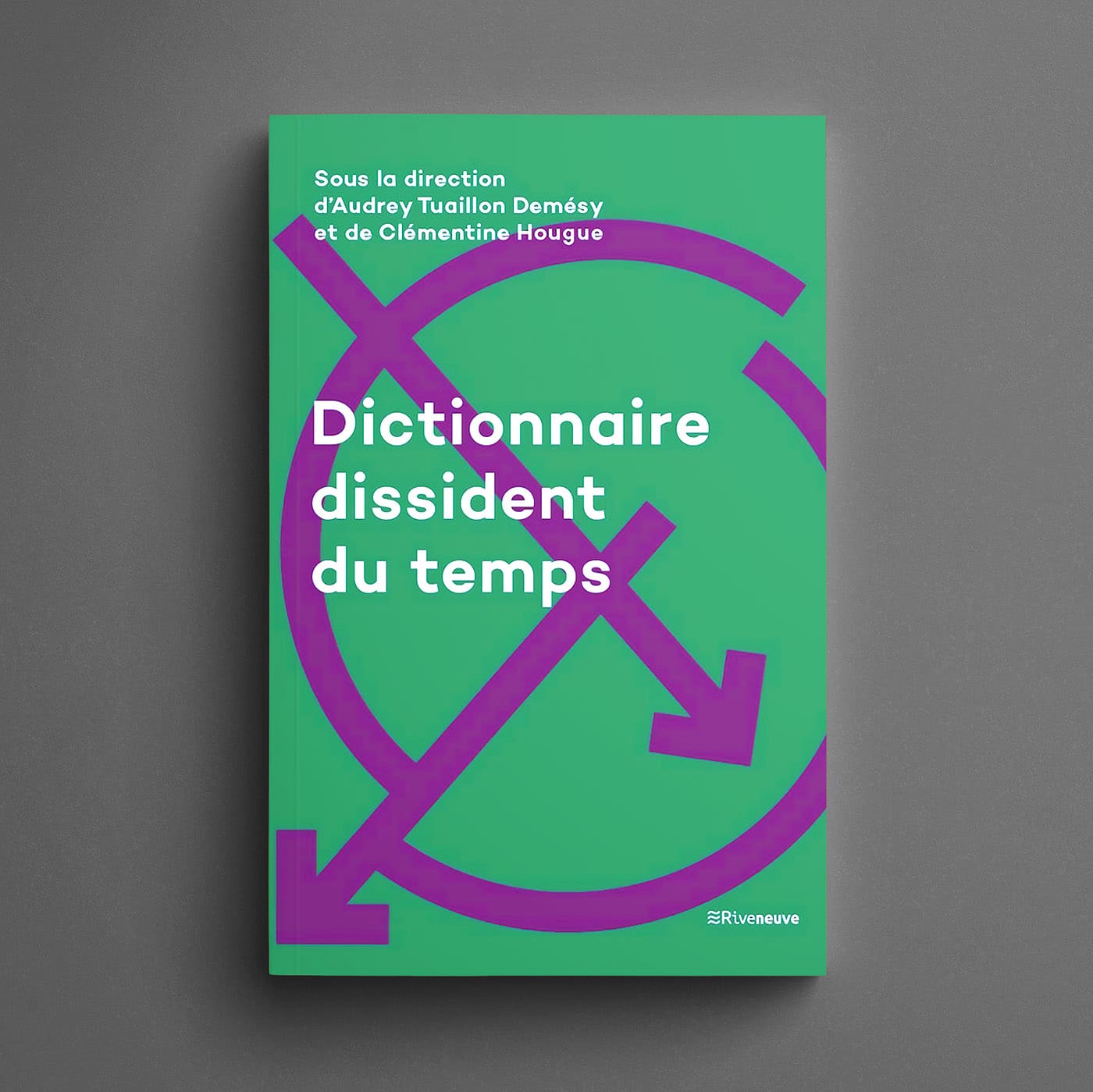
Pouvez-vous revenir sur la genèse de cet ouvrage ? Qui en est à l’origine ?
Audrey Tuaillon Demésy : L’histoire de ce dictionnaire remonte à juin 2021. Nous avions organisé un séminaire à Besançon, dans le cadre du programme de recherche Aiôn, qui s’intéresse aux imaginaires du temps et aux pratiques alternatives. L’équipe du projet s’était réunie pour échanger sur un projet d’ouvrage collectif traitant du temps et des temporalités, selon une perspective pluridisciplinaire. Nous sommes en effet issus de différents champs académiques : littérature, sociologie, STAPS, sciences de l’information et de la communication, anthropologie, etc. Rapidement, nous avons été confrontés à l’ampleur des déclinaisons que le « temps » peut prendre. Après avoir établi une première liste, nous avons alors fait le choix de recentrer le propos autour de ce qui nous réunissait, c’est-à-dire les alternatives, les marges, les contre-cultures… Dès lors, à côté de notices fondamentales qui s’intéressent au temps dominant, au khronos, nous avons souhaité explorer d’autres formes d’expressions du temps. Au fil des mois et des échanges, souvent informels, nous avons ainsi établi et arrêté (il faut savoir mettre un terme, arriver à la fin…) 91 notices, écrites par des membres d’Aiôn et des collègues extérieurs.
Clémentine Hougue : Au départ, nous avions en effet commencé, à la suite d’une proposition d’Audrey, par travailler chacun et chacune sur les temps propres à nos disciplines et/ou à nos objets. Je me souviens d’une visio où l’une de nous deux (je ne sais plus laquelle !) lance : « et pourquoi pas un dictionnaire ? » et que l’autre répond « c’est précisément à ça que je pensais ! ». Le reste de l’équipe a suivi, même si tout le monde était conscient que c’était un travail colossal – et plein d’embûches ! Mais je pense que c’est aussi cet aspect qui a stimulé tout le monde : faire un truc infaisable, se dire « chiche ». C’est vraiment la moelle du projet Aiôn, de mon point de vue : oser faire des choses qui semblent impossibles, ou décalées. C’est aussi ça qui nous soude en tant que collectif : « même pas peur ».
Le dictionnaire est un objet que je trouve fascinant : tenter de cartographier le réel, en utilisant le classement alphabétique, qui est au fond le plus arbitraire qui soit, et en offrant la possibilité d’une lecture non linéaire, me semble être un mouvement de la pensée assez extraordinaire. Mais c’est une entreprise nécessairement incomplète : faire un dictionnaire est un formidable exercice de gestion de la frustration. (sourire)
Audrey Tuaillon Demésy : Oui en effet, pour se lancer dans la coordination d’un dictionnaire, il faut être un peu obsessionnelle, un peu masochiste aussi… Pourtant, Agnès Vandevelde-Rougale (qui a rédigé la notice « Travail ») nous avait prévenues ! Elle a elle-même co-dirigé un dictionnaire de sociologie clinique, il y a quelques années, et je me souviens l’avoir vue au moment du bouclage, me disant que c’était une erreur à ne pas faire. Mais je crois que nous aimons ça, en fait…
La direction d’ouvrage est très différente de l’écriture en solitaire. Elle demande des accommodements, des compositions. Comment s’est passé ce travail d’écriture collective ?
Clémentine Hougue : Ce que nous avons demandé aux personnes qui ont accepté de se lancer dans ce travail était infiniment exigeant – nous remercions ici encore toutes et tous de s’y être plié : pour des raisons éditoriales, et de fabrication, les notices sur des notions ne devaient pas excéder 7000 signes, celles sur des auteurs, 5000 signes. C’est très court (2 à 3 pages environ). Pour nous qui avons l’habitude de développer nos analyses sur quelque 20 à 30 pages, c’est extrêmement compliqué : cela oblige à une forme d’épure, d’assèchement. Cela revient un peu à répondre à la terrible question : « si tu ne devais emporter qu’un seul livre sur une île déserte ? ». Comment ne garder que l’essentiel ? Et surtout : « qu’est-ce que l’essentiel d’une notion, d’un auteur ? » On retrouve ici la question du choix, celle de la fatale incomplétude : on ne pourra, de toute façon, pas tout dire. Il faut alors se poser la question de ce qui est indispensable dans chaque notice, au regard de notre objet qu’est le temps.
Et c’est là, qu’étonnamment, le nombre de signes devient presque un élément temporel : il faut faire au plus court, aller « rapidement » au but, dire le plus important dans un « temps » limité. Ça crée une paradoxale forme d’urgence : il faut expliquer vite ce qui te semble indispensable sur la question que tu traites. Comme si le temps se matérialisait dans ton propre texte : c’est un vertige. Mais un vertige que je trouve passionnant, qui nous oblige à éprouver – au deux sens de « ressentir » et de « mettre à l’épreuve » – le rapport que l’on entretient avec nos objets et nos concepts (j’avais un prof qui disait que si tu n’étais pas capable de « penser ta pensée » en quelques phrases, c’est que tu ne la maîtrisais pas vraiment…)
Un mot personnel sur cette expérience : j’ai écrit la notice « Roman » sur les encouragements d’Audrey notamment ; j’ai rarement autant ramé sur un texte. Le temps dans le roman, c’était tétanisant, impossible à circonscrire, à catalyser en deux ou trois pages. J’étais en proie à un doute total, presque une forme de peur (le texte a été révisé à l’aveugle, et ça m’a beaucoup aidé d’avoir les retours des experts !). In fine, je n’en suis plutôt pas mécontente, mais quelle épreuve ! Je compatis au sort des collègues qui ont eu à traiter d’autres entrées théoriques très vastes – et ils et elles sont nombreux.ses dans ce cas !
À côté de ça, j’ai adoré l’écriture collective : la préface avec Audrey, bien sûr, qui était la mise en mots de toute une démarche et tout un long travail. Dans cette pensée collective (ça vaut pour toutes les disciplines du projet Aiôn), c’est vraiment l’amont qui est fondamental : on doit se comprendre, comprendre comment fonctionnent nos disciplines, comprendre, en somme, nos incompréhensions. Ça m’a énormément enrichie. Mais aussi « Fins du monde », notice que j’ai écrite avec Manouk Borzakian, qui est géographe : c’était la rencontre de deux disciplines qui ne dialoguent pas si souvent (littérature et géographie), et ça a été extrêmement riche, et étonnamment facile (de mon côté en tout cas !). Je suis vraiment heureuse de ce texte, de ces échanges.
Pour la notice « Science-fiction », j’ai eu la chance d’écrire avec Zelda Chesneau, qui est une chercheuse brillante et une membre extrêmement active du fandom de la SF : elle anime, avec son comparse Le Technicien, la chaîne Twitch DoctriZ, qui est devenue incontournable dans ce domaine. Dans ce cas-là, c’était presque le contraire des autres textes écrits à quatre mains : nous sommes toutes les deux comparatistes, nos outils d’analyse mobilisent beaucoup la narratologie ; on parlait le même langage. Comme pour les autres textes, il fallait faire des choix, et là, on s’est assez rapidement accordées sur la manière d’aborder le temps dans la SF… Ce serait une approche par le temps du récit – évidemment pas le seul possible, mais le nôtre, en tout cas.
Dans toutes ces expériences d’écriture collaborative, ce que je retiens, c’est la qualité des échanges, et la manière dont on a dialogué, dont on a dû s’écouter, débattre, ne pas être d’accord parfois ; je souhaite à tout le monde de vivre ça sous une forme ou une autre : une réflexion, une production, qui s’enrichit parce que les gens qui y travaillent pensent et procèdent différemment.
Audrey Tuaillon Demésy : Outre l’introduction, nous n’avons pas rédigé d’entrée commune… C’est vrai, c’est un peu dommage… Sans doute, le temps passé ensemble à penser et gérer cet ouvrage a-t-il compensé ce manque… Sur cette direction d’ouvrage, nous avons d’ailleurs fait le choix, concernant l’ordre des noms qui apparaissent sur la couverture, de faire un tirage au sort. S’il n’est malheureusement formellement pas possible de faire apparaître les noms sur un même niveau, nous avons cependant souhaité déhiérarchiser le processus et laisser le hasard décider.
Clémentine Hougue : C’est vrai que nous n’avons pas écrit d’entrée ensemble, et en même temps nous n’avons fait que ça : nous avons pensé ensemble, échangé sans arrêt, défini et redéfini les contours de l’ouvrage, en laissant les collègues se l’approprier (du moins l’espère-t-on !). Mais la rédaction de la préface était une sorte de partition à deux voix particulièrement stimulante, chacune avec nos approches qui s’exprimaient : partager ces trois ans de travail et de questionnements et tâcher de les transcrire dans cette introduction était un très beau moment d’écriture (j’ai eu l’impression que c’était incroyablement facile, dans un contexte de bouclage qui ne l’est jamais. Audrey aura peut-être une autre vision des choses). (sourire)
Audrey Tuaillon Demésy : Oui, malgré les difficultés et les doutes, différents à chaque moment du projet (quelles notices, quels thèmes, quels théoriciens choisir, privilégier, etc. ? Comment tenir les délais ? Comment et quand s’arrêter ? Comment accepter l’incomplétude de cet ouvrage ?), je garde un excellent souvenir de cette coordination. Parce que les doutes et les craintes ont été supplantées par le plaisir des rencontres avec les auteurs, la joie des lectures et des découvertes, celui de nos échanges avec Clémentine, qui nous ont obligées à préciser tout un ensemble d’éléments, notamment parce qu’il faut pouvoir se comprendre. Il n’y a pas très longtemps, un collègue jeune chercheur m’a contactée parce qu’il avait vu le dictionnaire et qu’il avait envie de se lancer dans une entreprise similaire – sur un tout autre thème – et il souhaitait avoir quelques conseils. Je lui ai dit, avant toute chose, de ne pas se lancer seul dans un tel projet mais de travailler avec quelqu’un d’une autre discipline, dans la mesure du possible, et avec qui il serait sûr de pouvoir passer plusieurs années. (sourire) Je pense que ce dictionnaire a resserré nos liens professionnels et personnels, avec Clémentine.
Il faut peut-être aussi rappeler que dans les moments les plus difficiles (notamment le bouclage, mais pas seulement), nous avons eu beaucoup de soutien de la part des collègues et amis qui ont pris part (ou non) à l’aventure. Les auteurs ont toujours été présents et bienveillants, de même que nos proches qui ont dû nous supporter dans certains moments de « crise » (tiens, « crise » aurait pu faire une entrée aussi). (sourire) Je suis ravie que ce dictionnaire ait abouti, mais comme j’ai des soucis avec les « fins », j’aimerais que l’on puisse continuer à le faire vivre : il n’est pas rare que l’on repense à des notices à ajouter, « pour plus tard » ou sous un autre format… Cela ouvre aussi des pistes et perspectives pour d’autres projets. C’est un aboutissement mais pas une fin.
Du côté des notices, j’ai co-écrit « U/A/Euchronie » avec Noémie Budin, chercheuse en littérature et « No futurism », avec Jim Donaghey, chercheur en philosophie politique, pour mon plus grand plaisir. Évidemment, cela oblige à repenser ses grilles de lecture, à faire un pas de côté pour proposer une notice qui respecte chaque discipline tout en proposant quelque chose de nouveau, une autre manière de voir, de comprendre, de lire, le sujet traité. Finalement, c’était aussi incroyablement facile, car malgré nos ancrages disciplinaires (voire linguistiques, avec Jim) différents, nous sommes parvenus à un consensus qui enrichit chacune de nos pensées. C’était aussi l’occasion de confronter nos points de vue et de les éprouver dans la grille de lecture de l’autre.
Un dictionnaire est par définition une somme, ou au moins la tentative d’obtenir une vue d’ensemble plus ou moins exhaustive d’un sujet. Comment vous êtes-vous assurées que l’ouvrage était, effectivement, « dissident », autrement dit singulier en ce cas ? Comment garantir le « pas de côté » nécessaire mentionné dans votre introduction ?
Audrey Tuaillon Demésy : L’idée initiale du format « dictionnaire » visait sans doute moins l’exhaustivité que la liberté : celle de l’écriture relative au cheminement intellectuel qui a pu nous guider, dans la recherche des notices à proposer comme dans celle des auteurs à solliciter ; mais aussi celle de la lecture. Nous voulions laisser la possibilité aux récepteurs de cheminer dans l’ouvrage, d’y chercher des notices précises ou, au contraire, d’en découvrir et de s’étonner. Moins qu’une totalité impossible à atteindre, nous souhaitions plutôt mettre en dialogue plusieurs conceptions du temps, de la physique à la sociologie, en passant par la littérature. Par le surgissement de notices qui peuvent paraître de prime abord déconcertantes, nous souhaitions laisser une place à l’inattendu. Le format « dictionnaire » nous a ainsi permis de penser le temps dominant, celui du progrès, rationalisé, propre de nos sociétés occidentales contemporaines, le khronos, mais aussi les alternatives qui peuvent exister, les interstices dans lesquelles se nichent des temps « autres ». Finalement, ce sont les imaginaires du temps qui sont traités par cet ouvrage qui vise une ouverture des possibles et invite à passer du khronos à l’aiôn, à y revenir…
Clémentine Hougue : Le « pas de côté », précisément, on ne peut pas le garantir. Il réside dans une tentative, pas dans un résultat. Le résultat, c’est justement la logique temporelle libérale dans laquelle toute action, tout investissement dans une activité qui prend du temps, doit arriver à un résultat « opérant » (pour reprendre un terme à la mode). Or notre démarche était moins le résultat que le mouvement, le point de départ : s’interroger sur ce qui semble souvent aller de soi. Est-ce que, lorsqu’on pense à ce qu’est le temps, on pense à des mots comme « zones » ou « carnaval » ? Pas d’emblée, il me semble. L’idée de ce dictionnaire n’est donc pas d’être exhaustif et s’il est dissident (l’est-il ? La question reste ouverte) ou s’il se veut dissident, c’est qu’il n’est qu’un point de départ, une invitation à interroger le temps « tout le temps ».
La première citation de l’ouvrage est tirée du film de Gébé et Jacques Doillon L’An 01, sorti sur les écrans en 1973 : « On arrête tout et on réfléchit. On nous dit : le bonheur c’est le progrès, faites un pas en avant. Et c’est le progrès… Mais ce n’est jamais le bonheur. » Vous semblez placer l’ouvrage dans un champ plus large, à la fois politique, sociologique, voire hédoniste, typique de la France de l’après 1968.
Clémentine Hougue : Le temps est politique, évidemment ; sociologique, sans aucun doute. Quant à voir dans la citation de Gébé et Doillon un hédonisme post-68, je ne suis pas d’accord. Au contraire, j’y vois une forme d’inquiétude assez visionnaire sur une conception exclusivement linéaire du temps : « le progrès, ce n’est jamais le bonheur ». C’est toute l’aliénation des classes ouvrières depuis les révolutions industrielles qui s’exprime là, ce sont Les Temps modernes de Chaplin, aussi bien que le roman social américain d’un Steinbeck ou d’un Dos Passos. Par ailleurs, L’An 01, c’est davantage la critique du spectacle situationniste et l’art du détournement que l’esprit 68 hédoniste. Pour ma part, j’y vois de la lutte et de l’inquiétude plus que de l’hédonisme.
Audrey Tuaillon Demésy : Dans cette continuité, on peut aussi lire dans cette citation l’association entre l’avancée temporelle (autrement dit le khronos) et le progrès, par opposition au bonheur. Si la société de consommation d’après-guerre a valorisé le progrès et, partant, le bonheur, le présent révèle bien qu’en effet, « le progrès, ce n’est jamais le bonheur ». Ce dernier n’est ainsi pas forcément relié à un temps linéaire cumulatif…
Si vous prenez soin de ne pas renvoyer à des figures publiques pourtant omniprésentes, aujourd’hui comme au moment de la rédaction de l’ouvrage, le Dictionnaire dissident est une somme éminemment politique.
Audrey Tuaillon Demésy : Le Dictionnaire dissident questionne moins la politique que le politique. Il ne s’agit pas de traiter de l’actualité, si ce n’est celle de la recherche. De fait, le temps ici est pris dans une continuité : que peuvent encore nous apprendre les conceptions du temps des philosophes de l’Antiquité ou du 19ème siècle, par exemple, pour penser notre monde contemporain ? Des notices telles « Capitalisme », « Anarchisme » ou « Travail » questionnent bien, chacune à leur manière, ce politique, ce que nous visons au quotidien. À l’inverse, des entrées comme « Mythes », « Voyage dans le temps », « Fantasy » ou « Anachronisme » invitent à ce pas de côté que nous recherchons : penser autrement, penser la fiction, l’impossible, l’utopie, pour mieux comprendre les logiques à l’œuvre aujourd’hui au regard de notre organisation temporelle.
Clémentine Hougue : Je ne vois pas bien à quelles figures publiques on aurait bien pu renvoyer qui en vaillent la peine. (sourire) Justement, tout le projet du dictionnaire réside peut-être dans le fait de dissocier la notion de « temps » de celle d’« actualité ». Je plagierais bien Baudrillard, qui écrivait, dans Simulacre et simulation : « nous sommes dans un univers où il y a de plus en plus d’information et de moins en moins de sens » en « nous sommes dans un univers où il y a de plus en plus d’actualité et de moins en moins de temps ». L’actualité, c’est peut-être ce qui est devenu dominant dans notre rapport au temps, mais nous empêche de le penser. En mobilisant les expertises des chercheuses et chercheurs qui ont participé à ce dictionnaire, on a essayé (peut-être un peu réussi) de court-circuiter ça : penser d’abord le temps, pour (éventuellement) donner à réfléchir à l’actualité. En ce sens, ce que dit Audrey est totalement fondamental : il ne s’agit pas de la politique mais du politique, au sens de la « polis », de la vie de la cité, de notre devenir collectif. Et ce dernier ne peut être réellement collectif que dans la mesure où il ne s’agit plus seulement de réactions à chaud à l’actualité (bien normales au demeurant, sur le plan individuel), mais en effet dans ce pas de côté, cette façon de regarder les phénomènes avec une focale différente.
Les travaux de recherche sur l’intelligence artificielle se heurtent eux-mêmes à l’accélération des processus d’apprentissage (Nature : Nicola Jones) ou au développement potentiel d’horloges nucléaires et non plus atomiques (Ekkehard Peik et Christian Tamm). Tout ce qui paraissait sûr, évident, vérifié, au sujet du temps semble de plus en plus hypothétique. La science est ainsi constamment remise en question. Comment, en tant que chercheur, ne pas se laisser dépasser par la perception d’un « temps » perpétuellement réévalué ?
Clémentine Hougue : Se laisser dépasser, c’est un vrai problème de chercheur. Le fait que la perception du temps soit constamment réévaluée, c’en est un autre. Le premier problème est d’ordre méthodologique : comment fait-on, concrètement, pour que nos objets ne soient pas obsolètes sitôt analysés ? Ça demande une veille constante, et une adaptation de notre appareil critique à toutes ces mutations. Le second problème est un objet en lui-même : le temps constamment réévalué s’observe dans tous les champs scientifiques : tu cites ceux de la physique, mais ce doit être tout aussi vrai pour un terrain en sociologie, ou sur des pratiques d’écriture.
Audrey Tuaillon Demésy : Je dirais aussi, pour compléter, que la question du rapport au temps dans la recherche est devenue omniprésente. Il suffit d’écouter un peu les chercheurs pour se rendre compte que tous sont en dette de temps, parce que les tâches se superposent et que les outils numériques participent à formaliser des attentes réduites en termes de délais temporels… L’accélération touche alors aussi le domaine de la pensée… Et pourtant, le temps de la recherche est un temps long, qui implique justement de devoir « prendre son temps », pour penser, observer et analyser des mécanismes sociaux, par exemple. Le monde scientifique doit désormais répondre aux injonctions du temps court, celui des appels à projets, qui doivent être finis avant d’être commencés… On en arrive ainsi à des situations ubuesques, dans lesquelles des chercheurs demandent des financements pour des projets déjà faits parce qu’il faut justifier du travail mené dans un temps extrêmement réduit.
Clémentine Hougue : J’ajouterai, dans le prolongement de ce que dit Audrey, que ce dictionnaire est né, aussi, d’une volonté de penser le temps non pas seulement dans sa dimension quantitative (comme elle le dit très justement, on ne cesse de compter le temps qu’on a, celui qui nous reste, parfois jusqu’à l’absurde) mais surtout de se pencher sur la qualité du temps. En ce sens, j’ai l’impression qu’on a d’emblée réfléchi à ce dictionnaire dans la perspective de Bergson : on a tenté de distinguer le temps comme élément qu’on mesure (qui est en réalité de l’espace : celui qui sépare une seconde d’une autre, ou une année d’une autre) du temps qu’on éprouve, ressent, expérimente – individuellement et collectivement –, ce qu’il s’y produit. Bon nombre d’entrées soulèvent d’ailleurs cette tension entre temps mesuré et temps vécu. C’est ce que Bergson appelle « la durée » et qu’Arnaud Bouaniche, dans sa notice sur Bergson, définit comme « continu, hétérogène, indivisible, successif, mobile, etc. » (p. 55) : en bref, tout ce qui n’est pas mesurable et que l’IA ne pourra jamais (je pense) réellement appréhender (à moins qu’un jour l’IA ne sache ce qu’est l’ennui, l’attente de l’être aimé, l’impatience, l’euphorie d’un moment particulier, etc. : ce dont je doute fort !).
À ce propos, une entrée, en particulier, propose un « pas de côté » inédit encore dans le domaine de la recherche : « Gagner du temps », écrite par ChatGPT 3.5, pour laquelle l’intelligence artificielle, sous votre contrôle et votre œil critique, multiplie des poncifs sur « l’adoption de stratégies d’organisation », le « niveau de productivité élevé » ou encore la « priorisation des tâches ». Les multinationales, dont OpenAI, ont-elles, en ce cas, déjà remporté la bataille d’une caractérisation du temps (productif, oisif, libre, rentable, etc.), voire une bataille culturelle ?
Audrey Tuaillon Demésy : La question dépasse sans doute largement la seule question du temps. Mais effectivement, cette notice donne clairement à lire la novlangue manipulée par les agents conversationnels, ainsi que l’idéologie néolibérale sur laquelle ils reposent pour donner à penser le monde.
Clémentine Hougue : On a en effet « joué » avec les biais de l’IA pour tâcher d’en faire émerger le discours libéral caché (mais pas vraiment) sous la promesse d’objectivité de la machine censée ne transcrire qu’une compilation de « faits ». Ce n’est évidemment pas le cas, et c’était intéressant de déconstruire la pseudo-objectivité de l’IA à ce sujet. Sur la question de la « bataille temporelle », deux éléments me semblent importants. Le premier : les multinationales ne remportent des batailles que si l’on abandonne le terrain. L’IA, comme tout le domaine du numérique, existe dans des déclinaisons open-source. Seconde remarque : ne voir l’IA que comme un gain de temps est extrêmement réducteur. Cela peut être une façon d’ouvrir son champ de réflexion, de faire différemment : encore faut-il l’utiliser en ce sens. Comme toute technologie, c’est en même temps un poison et un remède, un pharmakon : à nous de décider ce que nous voulons en faire. Comme le postule Bernard Stiegler « [c]e pharmakon est nécessairement toxique tant que de nouvelles thérapeutiques n’en sont pas prescrites, c’est-à-dire tant que nous ne prenons pas nos responsabilités. » (Stiegler, 2015 : 65). C’est donc une affaire éminemment collective.
Audrey Tuaillon Demésy : Je n’ai pas grand chose de plus à ajouter, si ce n’est, peut-être, que la question de ce que peut produire un agent conversationnel type ChatGPT est aujourd’hui un questionnement prégnant, que ce soit en recherche ou en enseignement. Nous voulions, avec cette notice, mettre en exergue les limites de l’outil, dans une forme de parodie (finalement, ChatGPT est aussi devenu un auteur du dictionnaire…).
On peut constater un prolongement, sinon une filiation, entre les théories de philosophes comme Héraclite circa 500 av. J.-C, et, bien plus tard, Friedrich Nietzsche, Michel Foucault puis Gilles Deleuze à la fin du 20ème siècle. Avez-vous pu identifier des penseurs dont les théories sur le temps et la temporalité semblaient, a contrario, davantage isolées, ou la caractérisation du temps s’inscrit-elle obligatoirement dans une doctrine, un mouvement de fond ?
Audrey Tuaillon Demésy : Les imaginaires du temps traduisent des pensées qui sont autant de produits d’une époque donnée et d’une conception du monde qui lui est attachée. Dès lors, chaque penseur propose un travail sur le temps qui est situé. De fait, nous avons tâché, dans le dictionnaire, de mettre en dialogue différents imaginaires du temps, par les théories comme par les thématiques. Au temps physique répond ainsi le temps social ou le temps fictionnel. Au temps de l’avant (des philosophes antiques ou d’entrées telles « Archéologie » ou « Mémoire ») répondent des propositions qui s’intéressent aux temps de la fin (« No futurism », « Fin du monde », etc.), comme celles qui sont éminemment inscrites dans le kaïros (« Gagner du temps », de même qu’« Accélération » ou « Lenteur » qui sont d’actualité, comme on vient d’en parler). Je dirais également qu’en fonction des domaines disciplinaires, certaines théories ou certains penseurs sont davantage plébiscités que d’autres. Le temps abordé du point de vue de la littérature ne convoque pas nécessairement les sociologues du temps, et inversement. Les notices « auteurs » visent alors aussi à permettre le décloisonnement disciplinaire en montrant ce que la théorie soulevée par un philosophe, un anthropologue, un historien, etc. peut apporter à une « pensée » du temps, quels que soient l’objet ou la discipline concernés.
Clémentine Hougue : Tout dépend de ce qu’on définit comme doctrine. Le temps hégélien repris par Marx est-il encore « une doctrine » ? Peut-on parler de « mouvement de fond » aujourd’hui ? Des « pensées isolées », sans doute, mais par rapport à quoi ? Au grand public ? Au monde académique ? Tout dépend de la focale. Il y a bien des philosophes contemporains essentiels sur ces questions, mais je ne sais pas si Hartmut Rosa pour l’accélération ou François Hartog pour les régimes d’historicité sont isolés ou pas. Hartmut Rosa, sociologue, postule que l’accélération (technique, sociale et des rythmes de vie) qui caractérise le monde contemporain représente un danger pour le progrès social : à courir après le temps, nous ne pouvons plus penser correctement notre devenir collectif. François Hartog, historien, analyse notre rapport au temps comme « présentiste » : le futur n’étant plus porteur d’espoir, nous sommes coincés dans un « présent qui cannibalise les autres temps », comme l’écrit très justement Patrick Garcia (p. 263), qui nous a fait l’honneur de rédiger la notice « Régimes d’historicité ». Rosa et Hartog, deux penseurs majeurs, peuvent être considérés comme révélateurs d’un mouvement de fond (je n’irai pas jusqu’à dire une doxa) sur l’analyse contemporaine du temps : l’accélération et l’immédiateté dominent notre rapport au temps. À ce propos, Yves Citton, dans la notice « Accélération », discute et nuance avec beaucoup de finesse « la tonalité lamentatoire qui domine actuellement les discours sur l’accélération » (p. 17).
Existe-t-il un rapport entre le Temps et la marge ?
Audrey Tuaillon Demésy : La question des marges culturelles est intéressante et évidemment au centre de nos préoccupations respectives, me semble-t-il. La marge ici, c’est d’abord de vouloir faire un dictionnaire du temps qui, comme son nom l’indique, prend le parti-pris d’être dissident. Dans ce contexte, les marges culturelles, ce sont aussi les entrées choisies, dont certaines illustrent à merveille cette idée. Nous voulions, par ce biais, proposer des pistes de réflexions, pour penser autrement, en dehors des normes de la recherche, peut-être, qui induisent parfois ce qui est légitime ou non, voire ce qui est considéré comme digne d’intérêt. C’est ainsi que la culture punk se retrouve dans plusieurs notices, de même que la question des avant-gardes.
Clémentine Hougue : En effet, alors que l’on vient de disciplines très différentes (socio-anthropologie pour Audrey, littérature comparée pour moi), nous avons en commun un intérêt pour les marges : chacune avec nos outils et nos méthodes, nous travaillons à analyser ce qu’elles sont, ce qu’elles pensent et ce qu’elles font. Dans ce dictionnaire, pour ma part, j’ai découvert des marges culturelles dans des espaces et des temps que je ne soupçonnais pas (parce que je ne les connaissais pas, ou très mal) : par exemple, l’anthropologue Sylvie Poirier explique que le rêve, dans certaines sociétés non-occidentales, est « un art de la rencontre, un espace-temps de réceptivité et de communication accrues avec d’autres personnes et entités, humaines et non-humaines » (pp. 266-267). Je trouve cela très éclairant par rapport à nos normes occidentales, qui tendent à circonscrire le rêve au domaine de la psyché, donc de l’intériorité, de l’individu. De même, j’ai découvert que ce que je pensais marginal ne l’était pas forcément de tout temps. Par exemple, « la marginalité des prophètes au regard du clergé », comme l’écrit Gwladys Le Cuff (p. 237), n’est pas uniquement une mise au ban : l’historienne de l’art explique que « ce régime d’exception [des prophètes] permit ainsi la parole publique des femmes, exclues des fonctions sacerdotales et politiques » (ibid.). Je trouve que cette perspective historique est passionnante : elle interroge sur ce que « marge » veut dire, et oblige à repenser constamment depuis quel centre la marge se détermine.
Enfin, si vous deviez choisir une entrée chacune ?
Audrey Tuaillon Demésy : Je trouve cette question très difficile… Le choix d’une notice peut dépendre d’intérêts de recherche actuels et de sensibilités personnelles (dans ce cas, je dirais sans doute « Fin du monde »). Mais cela peut aussi être relatif à la découverte d’une approche, d’un thème, d’une façon de penser nouvelle ou d’un sujet qui a été marquant… Dès lors, ce serait sans doute « Opalka » car c’est probablement l’entrée qui traduit mon pas de côté… Avoir découvert le travail de cet artiste qui donne à voir, au sens premier, le passage du temps a été pour moi assez saisissant. Comme le rappelle l’autrice de la notice, Anne Beyaert-Geslin, l’une des productions artistiques d’Opalka articule ensemble le temps (les autoportraits) et l’espace (la distance entre les photographies) pour exposer une expérience anticipatrice de la mort. L’observateur voit ainsi le temps… Je trouve cela tout à fait fascinant, et cela traduit bien, aussi, les questionnements que nous avons eus : comment parler du temps, comment le décrire, le penser mais aussi, finalement, comment l’observer ? Il y a ici des pistes de réponse… Enfin, je pourrais également citer la notice « Aiôn/Khronos/Kairos » ou encore « Rêver », parce que celles-ci également, illustrent à merveille ce qui entoure tout ce que nous avons fait durant les trois dernières années. (sourire) Mais c’est vrai que la question est difficile… Évidemment, certaines notices nous touchent davantage parce qu’elles résonnent particulièrement avec nos propres questionnements. Mais toutes nous ont apporté de la matière à réfléchir, du plaisir à la lecture, mais aussi (et c’est ce qui est génial, et nécessaire), de la contradiction.
Clémentine Hougue : Cette question est parfaitement sadique… je vais donc répondre à côté ! Comme Audrey, la notice sur Roman Opalka – un artiste qui me fascine – est marquante du fait de la radicalité du rapport au temps de l’artiste. Mais en réalité, tout dépend des critères de ce choix d’entrée « préférée ». La notice « Hegel » de Christophe Bouton m’impressionne par sa capacité de synthèse d’une pensée aussi complexe : dans une phrase comme « Les choses ne sont pas dans le temps, puisque c’est le temps lui-même qui est dans les choses, sous la forme d’une négativité qui ne cesse de les transformer » (p. 133) apparaît toute la pensée hégélienne de la dialectique, accessible à qui ne l’a jamais lu. « Archéologie », écrite par Ségolène Vandevelde, me passionne parce qu’elle me donne accès à un domaine dont j’ignore à peu près tout, avec une grande précision, tout en étant extrêmement plaisante à lire – et c’est une discipline dans laquelle le rapport au temps est évidemment central. « No futurism », d’Audrey et Jim Donaghey, me ravit : la création de ce concept « comme manière de conjurer un futur anxiogène » (p. 210) et comme appel à agir au présent, collectivement, ouvre une réflexion politique dont je me sens particulièrement proche. « Sieste », proposée par Thierry Paquot, me réjouit beaucoup, par la contestation bartelbienne du « I would prefer not to » qui s’y niche – une manière de penser la richesse du temps non productif : elle s’achève sur ces mots, que je trouve très élégants : « Tout siesteur choisit son heure et son lieu : la sieste correspond alors à un moment de répit, un temps à soi, contrarié par aucune urgence professionnelle ou sociale. En ce sens, elle participe à une mini-renaissance aux allures de création » (p. 300).
Et il y a bien sûr toutes les entrées relatives aux arts (« Arts plastiques », « Avant-gardes », « Bande dessinée », « Cinéma », « Musique », « Poésie », etc. : ce serait trop long de toutes les citer), parce que ce sont des domaines qui sont des objets de recherche, ou simplement des arts que j’affectionne. Je pourrais continuer mais j’arrête là – à regret – sans quoi j’énumérerais les 87 autres entrées du dictionnaire ! Je pense, j’espère, que chacun et chacune pourra s’y faire son « best-of », en fonction de ses affinités.


